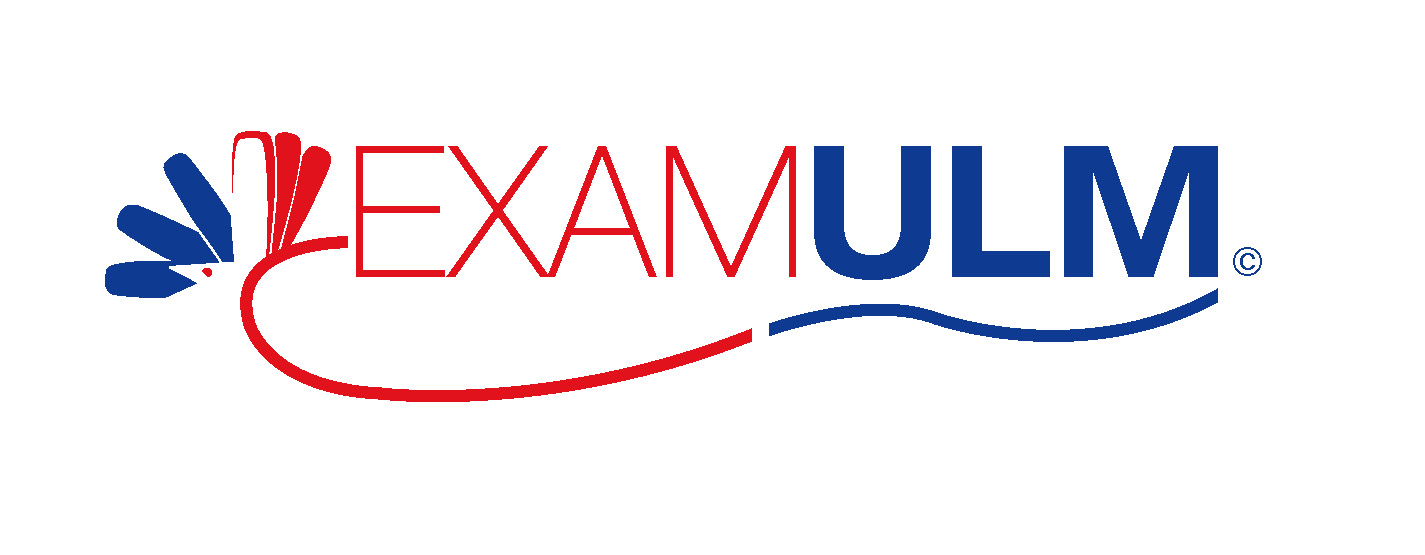Terrains ULM en montagne

Depuis le 10 janvier 1985, la législation prévoyait que « Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative. »
Inscrit dans le code de l’environnement depuis le 21 septembre 2000 (article L363-1), cet article a été modifié par la Loi 2021/1104 du 21 août 2021, dite loi « Climat et Résilience », et par la loi2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS.
Il est aujourd’hui rédigé comme suit :
I.-Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.
II.-Dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.
Première difficulté : qu’est-ce qu’une zone de montagne ?
La Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite « loi montagne ») établit un zonage strict de la zone de montagne, sur laquelle elle s'applique.
Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Ainsi, un terrain situé dans une vallée à une altitude faible peut se trouver dans une commune classée en zone montagne.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et est rattachée à un massif conformément au décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs, à savoir les Alpes, la Corse, le Massif Central, le Massif Jurassien, les Pyrénées et le Massif Vosgien.
Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne, également délimitées par arrêté interministériel, comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.
Comme vous le constatez, cette notion est particulièrement floue, surtout si on la compare à la définition aéronautique :
[95 ter SERA] Zone montagneuse : zone au profil de terrain changeant, où les différences d’altitude du terrain excèdent 900 m (3000 ft) sur une distance de 18,5 km (10 NM).
Qui n’est pas non plus satisfaisante car pénalisant des plateformes en plaine proche de reliefs importants.
Deuxième difficulté : qu’est-ce qu’un emplacement autorisé par l’autorité administrative ?
Concernant le paragraphe I, les terrains ULM permanents sont autorisés par le préfet, donc sont considérés comme des emplacements autorisés par l’autorité administrative.
La question est plus problématique pour les terrains occasionnels puisque ne disposant pas de l’autorisation du préfet, mais requièrent uniquement d’informer le maire de la commune. Le maire peut toutefois demander au préfet de s’y opposer en invoquant les nuisances que cela peut générer. S’il ne le fait pas, cela constitue une autorisation tacite de l’autorité administrative, puisque utilisé en application de l’arrêté du 13 mars 1986. Cette interprétation est parfois contestée par les forces de l’ordre, mais n’a jamais donné lieu à des poursuites qui auraient pu faire jurisprudence.
Troisième difficulté : qu’est-ce qu’une plateforme ULM ?
Le paragraphe II interdit le débarquement et l'embarquement de passagers, « sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports. »
Cet article L.6300-1 du code des transports précise que "constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs." Dès lors, il serait facile de considérer qu’un terrain ULM, bien que n’étant pas un aérodrome (l’arrêté du 13 mars 1986 est intitulé « arrêté fixant les conditions dans lesquelles les ULM peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome »), sont quand même « spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs », et donc n’entreraient pas dans le cadre de l’interdiction du code de l’environnement, ce que conteste la DGAC malgré les nombreuses demandes de clarification de la FFPLUM qui suit attentivement cette situation.
En conséquence, dans ces zones, la création de terrains ULM permanents est systématiquement restreinte aux vols sans passager à bord, situation particulièrement pénalisante qui concerne 30% du territoire métropolitain.