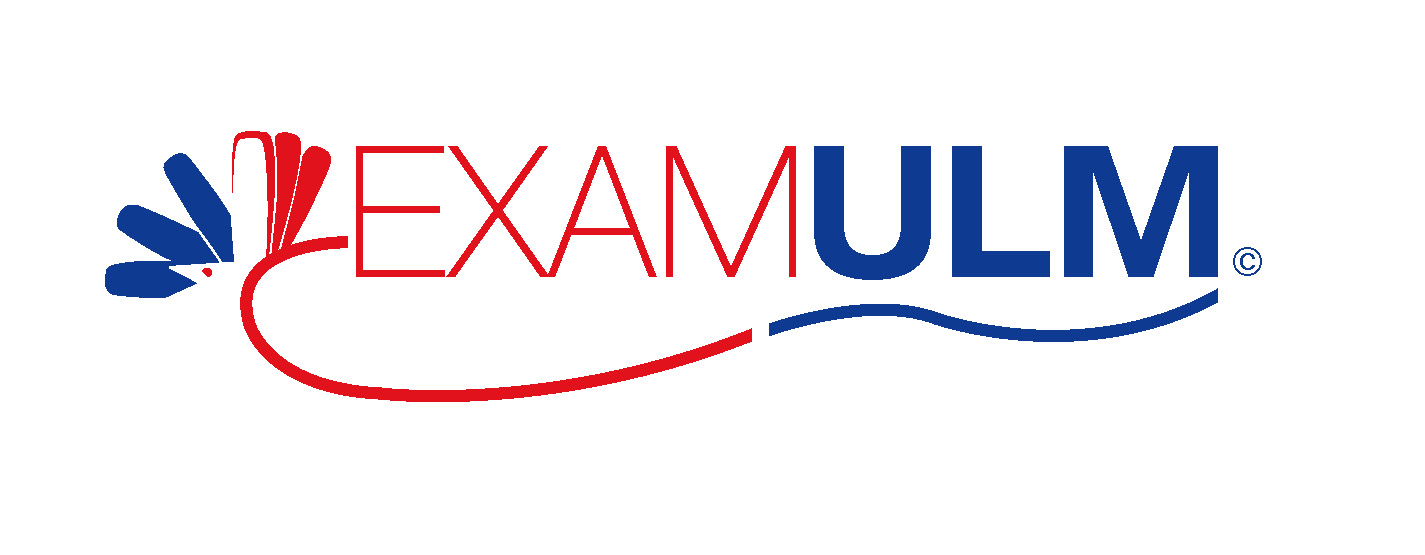Vous êtes responsable d'une structure affiliée à la Fédération Française d'ULM ? Nous mettons à votre disposition des garanties automatiques ainsi qu'une offre d'accompagnement, de service et d'assurances complètes.
Les garanties automatiques et gratuites pour les structures protègent et assurent
- Tous les bénévoles, salariés et acteurs même non-pratiquants qui aident au sein des structures.
- Tous les membres du bureau directeur, du comité directeur, des comités régionaux et départementaux et des pôles ainsi que les prestataires en mission pour la Fédération.
- Tous les dirigeants de club et OBL actuels et passés.
- Tous les pratiquants.
- Tout ce qui permet la pratique de l’ULM: phases d’accueil, de théorique, portes ouvertes, conséquences d’une erreur dans l’entretien ou la maintenance effectuée à titre bénévole, accident du fait du matériel de la structure, intoxication alimentaire survenue dans la vie du club…
Offre d’accompagnement, de service et d’assurances complète
- Responsabilité Civile Terrestre (ex : chute d’un particulier dans l’enceinte du club).
- Responsabilité Groupement Sportif (ex : négligence dans l’entretien des installations, défaut dans la coordination des activités, défaut de signalisation…).
- Responsabilité Civile Dirigeants (ex : faute de gestion d’un dirigeant dans les activités de sa structure).
Des questions ? N'hésitez pas à contacter le service assurances de la FFPLUM.
Camille Ménard
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.