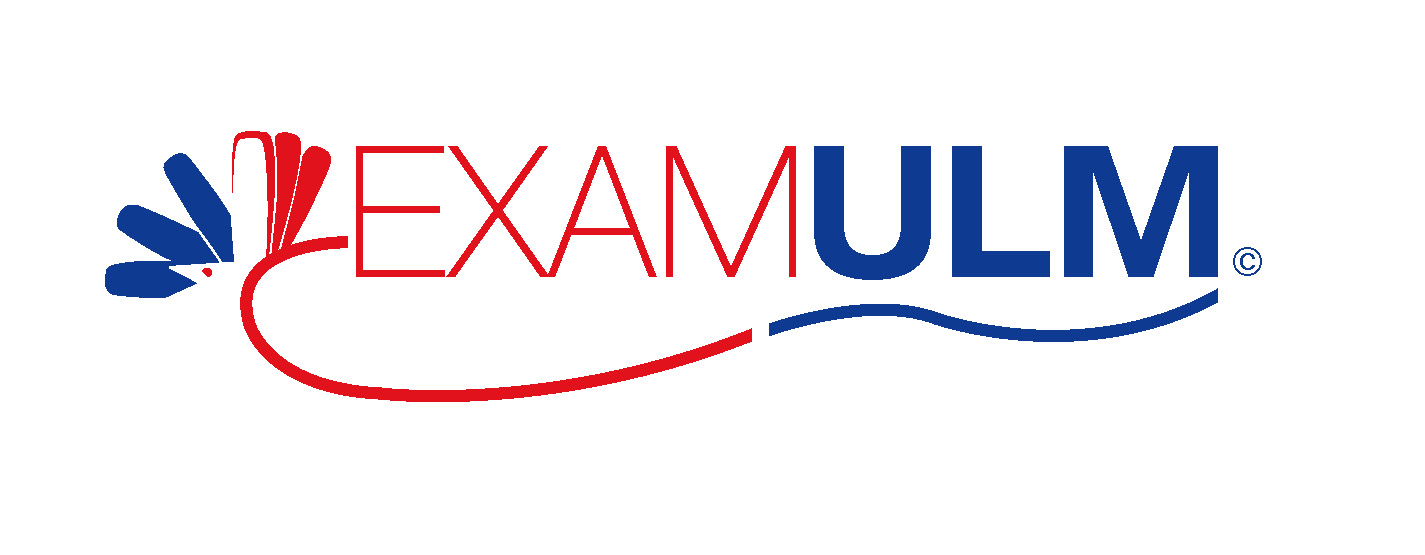Les championnats de France se sont déroulés sur la base de Levroux dans un créneau météorologique étroit qui a permis un parfait déroulement des épreuves. Ces championnats ont été avant tout marqués par l’esprit de la famille Touitou, Naëlle Touitou, fille des époux Touitou, tragiquement disparus il y a un an et personnalités historiques du paramoteur, a été présente tout au long des épreuves, apportant sa gentillesse et son investissement dans l’organisation avec l’esprit « sport et ULM » qui est la marque de famille et qui correspond à son propre trajet d’études. Merci à Naëlle pour cette belle présence !
Ces championnats ont été également marqués par la très grande diversité des participants. Plus de 70 participants, avec un bon équilibre entre les paramoteurs et les Classic Class (autres classes), les championnats de France mélangent désormais toutes les classes, avec aussi des nouveaux compétiteurs qui viennent « gratter » la compétence des plus anciens. Fait également intéressant, la présence féminine sur les podiums depuis quelques années maintenant avec 5 femmes en 2024 dont 3 titres nationaux à l’instar de Rose Michelland, âgée de 13 ans et plus jeune titrée en paramoteur biplace. Mais au-delà de ce vivier élargi, qui est un effet des très nombreuses compétitions régionales organisées dans toutes les classes, les championnats sont une école d’excellence dans la pratique du pilotage. Nos champions portent haut la compétence technique.
Cette exigence de qualité et de performance, encouragée par le fait que la Fédération est désormais (depuis trois ans) sport de haut niveau, pour le slalom dans un premier temps et nous l’espérons pour le paramoteur classique et les autres classes prochainement, est le résultat du travail dans le temps long des cadres techniques, direction technique et entraîneurs nationaux, qui du régional au national à l’international ont capitalisé le meilleur de nos pratiques sportives. Nous tenons tout particulièrement à saluer le rôle de Pascal Vallée, entraîneur national en paramoteur, qui a annoncé que cette saison serait la dernière. La transition sera assurée d’ici là.
Merci enfin au club de Levroux et en particulier à notre chère Denise Lacote, par ailleurs trésorière de la Fédération depuis 23 ans, qui ont apporté toute leur passion et tout leur dévouement pour inscrire ces championnats dans l’histoire de cette base si profondément liée à la Fédération et à l’ULM.
La saison sportive a donc bien commencé, rendez-vous pour les championnats du monde en Angleterre cet été, pour la finale de la compétition de STOL au MULM et sur toutes les compétitions prévues en région. Une partie de nos sportifs feront l’ouverture du meeting de la Ferté-Alais, plus de 30 ans après le vol de Didier Eymin en paramoteur. Un beau symbole !
Sébastien Perrot
Classement des championnats :
PRATIQUE MICROLIGHTS DISCIPLINE CLASSIQUE
Catégorie Multiaxes Biplace
- SEJEAU Louis Marie& MICOUREAU Adrien
- MOURIER Bastien & VILLA Julien
- AYNIE Jean-Claude & AYNIE Victor
Catégorie Pendulaire Monoplace
- BE Patricia & PAPERIN Émilie
- LE ROI Patrick & BERGEVIN Solène
- CHAMPON Mathieu& JACQUIN Cyril
Catégorie Pendulaire monoplace
- CARLOT Cyril
- REBOUILLAT Lison
- RONGEAT David
PRATIQUE PARAMOTEUR DISCIPLINE CLASSIQUE
PF1 Élite - Décollage à pied monoplace
- FONTANA Stéphane
- MICHELLAND Glenn
- MAUBAN Romain
PF1 Espoir - Décollage à pied monoplace
- DEUTSCH Séverine
- RICHARD Thomas
- DIEBOLT Maxime
PL1 – Chariot monoplace
- MERLE Michael
- PENONE Jeremy
- MALLARD Frederic
PL2 – Chariot biplace
- PLANTON Cyril & MICHELLAND Rose
- BREUZARD Fabrice & BREUZARD Oriane
- CLAVURIER Stéphane & PASQUIER Cyril